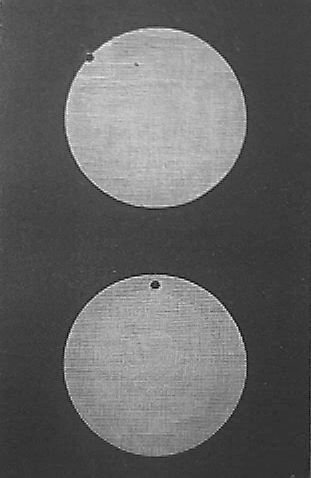
MISSION DE L’ILE SAINT-PAUL
POUR L'OBSERVATION
DU PASSAGE DE VÉNUS (∗1);
PAR M. E. MOUCHEZ,
CAPITAINE DE VAISSEAU.
Messieurs,
L'Académie des Sciences, vivement préoccupée, comme toutes les Sociétés savantes de l'Europe, du grand événement astronomique qui devait signaler l'année 1874, nomma, en janvier 1870, une commission chargée d'étudier la part que la France devait prendre dans ce concours scientifique de toutes les nations.
De cruels événements politiques, la mort prématurée de MM. Delaunay et Laugier, astronomes éminents qui avaient pris successivement la direction des travaux de la Commission, d’autres difficultés encore suscitèrent de telles entraves, qu'on put craindre un moment que la France ne fût pas prête à occuper la place que lui assignaient sa position scientifique en Europe et le souvenir de sa prépondérance dans les observations du passage de Vénus au dernier siècle.
Mais la Commission sentait trop bien tout ce qui était dû à la dignité du pays et à l’honneur de l'Académie pour ne pas agir avec la plus grande vigueur, afin de réparer le temps perdu. Au commencement de 1873, elle nomma pour son président M. Dumas, Secrétaire perpétuel, dont la haute position et l'énergique volonté contribuèrent puissamment à écarter tous les obstacles ; les travaux préparatoires marchèrent dès lors rapidement, les méthodes d’observation furent étudiées et arrêtées, et les instruments, commandés à des artistes français, purent être livrés en temps utile pour permettre aux observateurs d’en étudier le maniement.
A côté des études directes effectuées à la lunette par les astronomes, venait se placer un nouveau procédé d'observation : la photographie, appelée à jouer un rôle si nouveau et si important, donnait, en effet, le moyen de recueillir instantanément et de conserver l'image exacte de chacune des phases du phénomène; l'application en fut confiée à M. Fizeau, le savant physicien qui a tant contribué aux progrès de l'immortelle découverte de Daguerre. A la suite d'études délicates, il fixa les moindres détails des opérations, auxquelles s'exercèrent, sous sa direction immédiate, les observateurs appelés à Paris.
Enfin d'actives démarches furent faites auprès de M. le Ministre de la Marine pour régler avec lui tous les détails du précieux concours qu'il accordait à l'Académie, à laquelle il fournissait une grande partie du personnel et du matériel, ainsi que les moyens de transport pour les localités placées hors de la route des paquebots.
Pour rester dans les limites étroites imposées par de douloureuses circonstances à son budget, la commission dut se borner à envoyer quatre missions, deux dans l'hémisphère Nord, Pékin et Yokohama, deux dans l'hémisphère Sud, Campbell et Saint-Paul ; mais elle compensa cette infériorité numérique en dotant ces quatre missions de puissants instruments et en constituant deux missions auxiliaires, l'une à Nouméa et l'autre en Cochinchine. Les grandes difficultés nautiques et d'installation matérielle qu'on prévoyait pour les deux missions des îlots des mers australes engagèrent la Commission à les confier à des marins, bien qu'ils n'y eussent pas été préparés par une longue pratique des grands instruments astronomiques.
C'est ainsi que M. Bouquet de la Grye fut désigné pour la mission de Campbell ; la station de Yokohama fut confiée à M. Janssen, membre de l'Institut, et celle de Pékin à M. le lieutenant de vaisseau Fleuriais ; enfin j'eus l'honneur d'être choisi pour la mission de Saint-Paul(2).
Ce petit îlot, perdu au milieu du vaste bassin des mers australes, est le cratère d'un volcan à peine éteint, émergeant du fond de la mer à 280 mètres au-dessus du niveau de l'eau. C'est un rocher absolument stérile, inhabitable, sans eau potable, sans végétation et fréquenté seulement par des bandes de phoques, d'oiseaux de mer et de pingouins. Chaque année, pendant les trois mois d'été ; de décembre à avril, quelques marins malgaches de la Réunion viennent s’y établir pour saler et sécher cinquante à soixante tonneaux de morues qu'ils pêchent autour de l’île. Le temps est quelquefois assez calme alors, mais extrêmement brumeux ; pendant le reste de l’année l'île n'est pas abordable.
Les coups de vents y sont fréquents en toute saison ; ils y sont continuels aux équinoxes et acquièrent alors la force d'une véritable tempête : c'était précisément l'époque où nous allions y arriver.
La mer, entièrement dégagée de toute terre entre l'Afrique et l'Australie sur un espace de 2000 lieues, s'y soulève et se propage en toute liberté ; aussi les vagues y acquièrent-elles des dimensions inconnues dans les autres parages, et elles déferlent, avec violence tout autour de ce rocher, trop petit pour former un mouillage suffisamment abrité. Dans ces régions le ciel est généralement couvert ou très-nuageux pendant la saison des coups de vent d'avril à novembre, tandis que d'épais brouillards envahissent tout l'horizon pendant les trois mois d'été, quand les vents tièdes de l'équateur remplacent les vents polaires.
Tous les renseignements que j'avais recueillis soit auprès de M. R. Scott, le savant chef du service, météorologique de Londres, soit auprès des marins de la Réunion, étaient unanimes pour établir qu'à Saint-Paul les chances d'un ciel pur pour le 9 décembre étaient extrêmement minimes, 8 à 10 pour 100 au plus. Elles étaient en réalité moindres encore d'après l'expérience que nous allions en faire. Ces déplorables conditions de climat, les difficultés du débarquement et les chances d'avaries me laissaient donc, au moment du départ de France, bien peu d'espoir de réussir.
Mais la position entièrement isolée de Saint-Paul au milieu des mers australes donnait une telle valeur aux observations qu'on pourrait y faire, qu'il était absolument indispensable qu'une mission tentât l'entreprise, quelque minimes que fussent les chances de succès. A la fin de juillet, je quitte donc Paris accompagné de mes collaborateurs, MM. Turquet, Cazin, Vélain, de l’Isle et le Dr Rochefort, médecin de la marine, et le 2 août nous embarquons avec nos instruments sur le paquebot l’Amazone qui fait route le même jour pour Suez et la Chine.
Le 9, nous traversons le canal de Suez, et, après huit jours de la navigation la plus douce, nous nous trouvons déjà au fond de ce golfe de la mer Rouge, naguère encore si peu connu, si désert, et où je me rappelais n'être parvenu, dans une de mes premières campagnes, qu'après huit mois de la navigation la plus pénible et la plus dangereuse, c'est aujourd'hui un des passages les plus fréquentés du globe. Aussi les anciens marins ne franchissent-ils jamais ce canal sans éprouver un même sentiment d'étonnement et d’admiration à la vue de ce mince filet d'eau de si modeste apparence, mais si grand par les résultats obtenus et les conséquences bien plus grandes encore qu'il aura dans l'avenir. Diminuant de moitié la distance qui séparait de l'Europe les 800 millions d'Asiatiques de l'Inde, de la Chine et de la Malaisie, il déplace l'axe du commerce du monde. Par les nombreuses difficultés vaincues et le désintéressement si absolu qui a présidé à son exécution, cette œuvre rend immortel le nom de son auteur et restera dans les siècles à venir une des plus pures gloires de la France.
Mais cette extrême rapidité des voyages modernes obtenue par des paquebots à grande vitesse et par des isthmes coupés n’est pas sans inconvénients pour le voyageur imprévoyant dont le tempérament n'est pas doué d'une suffisante élasticité, pendant le peu de jours nécessaires pour passer des climats froids de l'Europe aux chaleurs torrides de la mer Rouge, l'équilibre rompu des fonctions vitales n'a pas le temps de se rétablir, et il en résulte souvent des morts subites dues à des maladies inflammatoires et à des congestions cérébrales. Un des jeunes passagers que transportait notre bateau, subitement asphyxié par une chaleur constante de 36 à 38 degrés, n'est rappelé à la vie qu’après vingt-quatre heures d'application de glace sur la tête.
C'est sans doute pour prévenir ces accidents que les anciens navigateurs avaient adopté la coutume de se faire saigner avant de traverser l'équateur.
Le 14, nous arrivons à Aden, le Gibraltar de la mer Rouge, où font, aujourd'hui escale les nombreux paquebots de l'Asie ; nous nous transbordons avec nos colis sur le Dupleix qui part trois jours après pour la Réunion. Nous rencontrons à bord de ce paquebot la mission hollandaise dirigée par M. Oudemans, habile astronome de Java, qui va observer le passage de Vénus à l'île de la Réunion ; le gouvernement hollandais avait d'abord voulu envoyer son unique mission aux îles Saint-Paul et Amsterdam, mais avait dû renoncer à ce projet en présence des grandes difficultés de débarquement et des mauvaises conditions de climat que présentaient ces îlots.
Nous arrivons le 30 à Saint-Denis.
Je trouve sur la rade le transport mixte de l’État la Dives, mis sous mes ordres par le Ministre de la Marine pour toute la durée de la mission. Ce navire, qui a déjà reçu de France notre matériel et nos marins, est prêt à partir pour Saint-Paul ; mais la nécessité de régler nos chronomètres m'oblige à faire un court séjour à la Réunion, et je fixe le départ au 8 septembre. Les marins pêcheurs qui fréquentent annuellement Saint-Paul, ainsi que le capitaine de la Dives, s'accordent cependant pour me conseiller de retarder d'un mois le départ de l'expédition ; ils m'affirment qu'il me sera impossible, en cette saison, d'accoster ce rocher et d'y débarquer mon volumineux matériel sans m'exposer à de graves avaries ; la mer y est beaucoup trop grosse et le vent trop violent ; mais un tel retard compromettrait trop les préparatifs de notre observation ; plein de confiance dans un heureux hasard et surtout dans ma ferme volonté de tout faire pour réussir, je pars au jour fixé.
Nous nous arrêtons quarante-huit heures à Maurice pour prendre à bord du Dupleix nos caisses d'instruments, qu'il eût été trop dangereux de transborder sur la mauvaise rade de Saint-Denis, et je profite de cette courte relâche pour aller visiter l'Observatoire de la mission anglaise ; j'y rencontre le Dr Gill, astronome attaché à lord Lindsay, prochainement attendu lui-même d'Angleterre avec le plus grand nombre de ses instruments. Cette expédition, qui a coûté plusieurs centaines de mille francs, a été entièrement faite aux frais de lord Lindsay ; noble usage d'une grande fortune, fréquent en Angleterre, mais mal récompensé cette fois, car le Soleil est resté couvert à l'île Maurice pendant une partie du passage de Vénus.
L'Observatoire était établi sur la grande propriété d'un riche planteur d'origine française, qui, nous recevant au milieu de sa nombreuse famille, selon toutes les règles de la proverbiale hospitalité créole, paraissait heureux de revoir des compatriotes et de leur manifester la vivacité de ses sentiments français. C'est un vénérable et excellent vieillard, familièrement appelé à Maurice « le patriarche », parce que, fervent adepte de la doctrine de Sweedenborg, à défaut de prêtre de sa foi dans ce pays, il s’est déclaré pontife de sa religion, prêchant, convertissant à sa doctrine sa nombreuse progéniture et lui administrant tous les sacrements, y compris celui du mariage. Pendant la visite qu'il me fait faire de ses vastes propriétés, je n'échappe pas à l'ardeur de son prosélytisme, et le lendemain, au moment où je sortais de la rade de Maurice, un exprès abordait la Dives et me remettait encore de sa part la volumineuse collection des œuvres de Sweedenborg et de longues lettres mystiques pour continuer l’œuvre de ma conversion jugée sans doute encore incomplète.
Pendant cette même excursion, je visite I'Observatoire météorologique situé dans cette vallée des Pamplemousses, où l’on chercherait vainement aujourd’hui les gracieux paysages décrits par Bernardin de Saint-Pierre ; et le directeur de cet établissement scientifique, M. Meldrum, veut bien me communiquer les nombreux documents sur lesquels il vient de fonder sa nouvelle et très-intéressante théorie des cyclones, ces dangereux ouragans qui dévastent périodiquement nos colonies tropicales.
Le 9 au soir, nous partons enfin de Maurice pour Saint-Paul ; cette traversée de quinze jours se fait lentement, mais avec beau temps, jusqu'aux approches de l’île ; nous n'étions plus qu'à une vingtaine de lieues, et je me berçais déjà de l'espoir d'atterrir par une des rares embellies de la saison, lorsque l'influence perturbatrice que les îlots isolés au milieu de l'Océan exercent toujours sur l'atmosphère environnante se fit sentir, et un fort coup de vent se déclara le 22 au matin ; les grains de grêle et la pluie sont continuels, la brume couvre tout l'horizon, la mer grossit, nous sommes obligés de mettre à la cape avec la crainte d'être emportés sous le vent de l'île sans la voir ; aussi, vers midi, une courte embellie s'étant manifestée et m'ayant permis d'apercevoir Saint-Paul dans la brume, je fis faire route pour le mouillage, vers lequel nous poussèrent rapidement le vent et une mer déjà fort grosse ; au coucher du soleil, nous contournions la pointe nord de l'île, et quelques minutes après nous laissions tomber l'ancre à 400 mètres de l'éboulement de la falaise par laquelle la mer a fait irruption dans le cratère.
Rien ne saurait donner l’idée du sombre et sauvage aspect des lieux qui venaient de s'offrir subitement à nos regards, et qui allaient devenir notre séjour ; il faisait presque nuit, nous étions dominés, à très-petite distance, par des falaises noires et à pic de 200 à 300 mètres de hauteur, dont les crêtes aiguës déchiraient les nuages, courant avec une extrême rapidité aux-dessus de nos têtes. Le vent, accompagné de grêle et de neige, tombait en violentes rafales dans le bassin du cratère et y soulevait de nombreuses colonnes d'eau tourbillonnant en forme de cyclone jusqu'à 15 ou 20 mètres de hauteur ; au premier abord nous crûmes être témoins d'une éruption d'eau et de vapeur sortant du fond du volcan. La Dives inclinait sous ces cascades de vent, tombant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et fatiguait sur son ancre, bien que la proximité de la terre rendît la mer assez plate ; mais on voyait d'énormes vagues bondir et écumer à quelques encâblures du navire et dessiner une énorme houle sur l'horizon, tant était restreint l’étroit espace où nous avions trouvé ce précaire abri. Quelques rares oiseaux de mer, bien surpris de notre présence, vinrent, en poussant leurs cris aigus, planer à quelques mètres autour de nous : c’étaient les seuls êtres vivants qui animaient cette solitude.
On distinguait vaguement, sur les revers intérieurs du cratère, des ruines de cabane sans toiture et de nombreux débris de naufrage d'un sinistre augure. Au milieu de l'étroit canal conduisant dans ce bassin, l'énorme carcasse de la frégate anglaise Mégéra, presque entièrement à sec, éventrée par le vent et la mer, se montrait entourée de ses nombreux débris, sur lesquels la mer déferlait comme sur un amas de rochers. Elle avait résisté depuis trois ou quatre ans à toutes les tempêtes : elle devait disparaître quelques jours après dans celle qui allait nous assaillir et rendre notre position si critique. Les plus fantastiques compositions de nos artistes modernes donneraient à peine une idée du tableau de désolation que nous avions sous les yeux.
Après une nuit pleine d'anxiété, pendant laquelle je puis me rendre compte du danger et des difficultés de notre position, je descends à terre aussitôt que le jour paraît, et, franchissant la barre entre deux lames, je débarque au pied de la falaise nord, près des ruines de cabanes. L'aspect imposant de ce bassin nous frappe d'étonnement et d'admiration ; nous nous trouvons au fond d'un gouffre circulaire de 1000 mètres de diamètre et à parois verticales de 300 mètres de hauteur, dont l'escalade semble absolument impossible sans échelle de corde ; les bords sont littéralement couverts de débris de naufrages.
La seule partie plane où l'installation de l'observatoire soit possible est la chaussée de galets, vestiges de l'éboulement par lequel la mer a pénétré dans le cratère, si toutefois les vagues ne la couvrent pas dans les tempêtes.
Je visite les principales huttes pour choisir celles que nous pourrons le plus facilement reconstruire ; en approchant de l’une d’elles, j'y entends avec surprise un bruit étrange et confus, et je me vois subitement assailli, près de la porte, par un troupeau de cabris et de chats sauvages, de rats et de souris qui s'en échappent dans toutes les directions ; j'en conclus, sans chercher davantage, que c'est la cabane la mieux conservée, et je la fais immédiatement déblayer de tous les immondices qui la remplissent pour en faire le jour même notre principal logement.
Les huit cents naufragés de la Mégéra ont construit ces huttes dans toutes les anfractuosités de rochers, et, au moment de leur départ, très-précipité sans doute, ils ont dû abandonner un matériel considérable, qui gît épars dans toutes les directions ; le terrain est couvert de barils, de caisses encore pleines d'objets divers : de mâts, de cordes, de poulies, d'ustensiles de ménages, de meubles de toute espèce, d'embarcations, etc. La vue de ces objets, irrécusables témoins d'un grand désastre, nous remplit de pitié ; mais, quelque avariés qu'ils soient après trois ans de séjour en plein air, nous n'en ressentons pas moins une certaine satisfaction par la perspective du confortable fort inattendu qu'ils nous promettent ; je trouve même dans ces caisses, au fond d'une de ces cabanes, plusieurs centaines de volumes composés des principaux philosophes anglais, français, allemands du XVIIIe siècle, d’ouvrages de théologie, d'énormes in-folio sur le droit canon et sur le « Parfait notaire » ; les rats semblent depuis bien des années avoir visité seuls cette bibliothèque, si étrangement composée pour des pêcheurs de morue ou pour les marins qui ont naufragé sur ce rocher.
Nous rencontrons sur le pourtour du cratère les nombreuses sources d'eau thermale citées dans les précédentes relations, et où l'on peut faire cuire en quelques minutes les homards que l'on pêche en extrême abondance sur tous les rochers environnants ; autour de nos cabanes, le sol est brûlant en bien des endroits à quelques centimètres de profondeur ; nos naturalistes ont constaté jusqu'à 200 degrés de chaleur en creusant à 1m,5 ou 2 mètres. Nous aurions donc un facile moyen de nous chauffer et de faire cuire nos aliments si le combustible venait à nous manquer. Nulle part, d’ailleurs, on n'apercevait d’autre trace de végétation qu'une herbe coriace, ressemblant à l'alpha de l'Algérie, et à peine suffisante pour donner quelque abri aux nombreux pingouins établis sur le versant des falaises, à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Ces curieux animaux, qui vont devenir nos amis et l’objet de notre plus grande distraction, sont tellement familiers que, pour traverser leurs groupes compacts, il faut les repousser du pied et de la main, afin de ne pas les écraser ; encore ne cèdent-ils pas la place sans protester. Quand nous nous asseyons au milieu d'eux, nous pouvons les prendre, les caresser ; ils reprennent bientôt après leurs occupations les plus intimes avec la même insouciance que s’il n’y avait rien de changé, sinon l'arrivée de quelques pingouins de plus. Extrêmement lents et lourds dans leur démarche sautillante à terre, c'est sans doute le sentiment de leur impuissance absolue à fuir le danger qui les rend si indifférents à notre visite ; car à la mer, où ils sont au contraire d'une extrême agilité, ils ne se laissent guère approcher à plus d'une centaine de mètres. A cette époque ils étaient occupés à couver. Mais par quel inexplicable motif, malgré la grande difficulté qu'ils éprouvent à marcher, vont-ils établir leur couvée au sommet des falaises qu'ils doivent escalader chaque jour avec une peine inouïe en revenant de la pêche, et où leur progéniture se trouve précisément beaucoup plus exposée aux attaques de nombreux oiseaux de proie établis sur les crêtes voisines ? Nous ne saurions le dire, n’ayant pu trouver de raison plausible d'un fait aussi singulier.
Après une rapide inspection des lieux, je fais commencer les travaux d'installation et le débarquement du matériel ; mais le vent souffle et tourbillonne avec une telle violence ; au fond de ce vaste entonnoir, que nous avons peine à nous tenir debout, et nous ne pouvons presque rien faire pendant cette première journée ; nous rentrons à bord au coucher du soleil.
Même temps le lendemain : fort vent de sud-ouest, grains continuels de grêle et de neige fondue ; la mer est assez grosse, les embarcations ne franchisent pas la barre sans danger ; vers 10 heures du matin, je vois tout à coup la Dives tomber en travers au vent et dériver ; elle a cassé son ancre sous une forte rafale, mais elle en mouille immédiatement une seconde avant d'avoir perdu l'abri de l’île, et elle résiste au vent. Nous rentrons encore le soir à bord, n'ayant pu que déblayer un peu le terrain et préparer quelques cabanes ; au moment du départ, un de nos compagnons, qu'incommode vivement le mal de mer, et qui, le matin, en embarquant dans le canot, a été plongé dans l'eau par un fort coup de roulis de la Dives, me demande à coucher à terre ; comme la mer est encore plus mauvaise et qu'il restera en compagnie de six pêcheurs malgaches que nous avons amenés de la Réunion, je lui accorde cette autorisation, bien que je ne sois pas sans une vive inquiétude sur l'apparence du temps.
Le lendemain, en effet, commence une forte tempête ; toute communication avec la terre devient impossible, le ciel est très-sombre, les rafales sont tellement violentes que la voix expire sur les lèvres, les grains sont continuels, la mer est blanche d'écume, mais assez plate encore, le navire fatigue beaucoup sur son ancre ; longue journée d'inquiétude et d'inactivité forcée ; le soir, je fais, pour plus de sûreté, mouiller une seconde ancre avec 120 mètres de chaîne, car l'appareil moteur ne peut être d'aucune utilité pour résister à ces rafales tourbillonnantes.
Je croyais avoir atteint le maximum de la tempête, mais il n'en était rien ; après une nuit passée dans une vive anxiété, une très-forte secousse, ressentie à 6 heures du matin, nous annonce la rupture d'une chaîne ; un quart d'heure après une nouvelle secousse nous annonce la rupture de la troisième ancre. La Dives emportée par l'ouragan, perd en quelques minutes l'abri de l'île, et est obligée de mettre à la cape avec une mer énorme et deux longues chaînes pendues à l'avant ; il fallut six heures d'un pénible travail, avec des appareils triplant la force du cabestan, pour les rentrer à bord du navire.
Pendant trois jours nous reçûmes une des plus fortes tempêtes que j’aie jamais éprouvées ; aucune lutte n'était possible, tous nos efforts devaient se borner à éviter les coups de mer et les accidents.
J'étais désespéré de la tournure que prenait notre tentative de débarquement à Saint-Paul : nous avions perdu trois ancres sur quatre pour débarquer une vingtaine de colis, comment pouvions-nous espérer en débarquer deux cents autres, avec la seule ancre qui nous restait ? Nous serait-il d'ailleurs possible de regagner Saint-Paul, si nous étions jetés à 50 ou 60 lieues sous le vent ? La Dives était incapable de remonter contre un vent et une mer contraires, même de force modérée, et tous les pêcheurs m’avaient affirmé que les coups de vent d'ouest se succédaient avec une telle rapidité dans cette saison que je trouverais rarement plus de vingt-quatre heures consécutives d'accalmie, soit pour opérer le débarquement, soit pour regagner le chemin perdu.
Si je ne pouvais raisonnablement tenter la chance du débarquement avec une seule ancre après avoir perdu huit ou dix jours pour revenir au mouillage, j'étais réduit à la grave alternative de retourner chercher des ancres à la Réunion en perdant six semaines ou deux mois, ce qui ne me permettrait de revenir à Saint-Paul que deux semaines avant le passage de Vénus, ou de laisser porter vent arrière et d’aller m'établir mille lieues plus loin, sur la pointe sud-ouest de l'Australie, pays désert peu connu et d'un bien difficile accès ; mais c'était une grave détermination à prendre que d'abandonner ainsi le poste que nous avait confié l’Académie pour aller en occuper un autre certainement plus désavantageux sous tous les rapports.
Aussi, avant d'en être réduit à une telle extrémité, j’étais décidé à tout tenter pour aborder Saint-Paul et à ne courir les chances bien hasardeuses de l'Australie que si une avarie de machine nous enlevait tout espoir de regagner le chemin perdu ; ces quelques jours d'une lutte opiniâtre d'où allait dépendre le succès de notre mission sont peut-être les plus critiques de ma longue carrière de marin.
Mais, le 28, le temps s'améliora un peu ; je fis aussitôt allumer les feux et commencer un louvoyage très-serré à la vapeur aidé par les voiles-goëlette. Veillant nuit et jour sur le temps et sur la machine, profitant des moindres variations de brise, je faisais donner au navire toute la vitesse qu'il pouvait supporter sans trop de dangers pour l'appareil moteur. Le capitaine Duperré n'était pas sans manifester son inquiétude sur la fatigue qu'éprouvaient le bâtiment et la machine ; mais, pour conserver quelques chances de réussir dans des conditions si difficiles, il fallait à tout prix user de toutes nos ressources jusqu'à la dernière limite ; car la plus petite négligence, une heure perdue, pouvaient nous faire manquer la seule occasion favorable d'effectuer notre débarquement. Le 30 au soir un fort coup de mer nous casse notre drosse en acier de gouvernail ; on la remplace par la barre franche et l'on continue la route ; les mouvements de roulis et de tangage, extrêmement vif et étendus, nous occasionnent encore quelques accidents : le capitaine Duperré, violemment jeté hors de sa couchette, est gravement contusionné ; la mer envahit le faux-pont et les chambres et noie une grande partie des animaux que nous devions débarquer à Saint-Paul pour notre approvisionnement ; enfin le 1er octobre à 9 heures du matin, après trois jours d'un louvoyage bien laborieux, nous avons l'extrême bonheur de revoir notre île et de laisser tomber notre dernière ancre au même endroit d'où nous avions été chassés huit jours auparavant. A peine sommes-nous au mouillage que notre compagnon laissé dans l'île arrive à bord vivement ému et heureux de nous revoir : il nous avait crus perdus.
Par le plus heureux et le plus inespéré des hasards, après un si mauvais temps, la barre ne déferle presque pas, elle est praticable et dégagée de la carcasse de la frégate anglaise qui a été détruite et engloutie dans le cratère ; aussi, quelques minutes après notre arrivée, toutes les embarcations étaient mises à la mer, chargées de colis et expédiées à terre dans l'ordre préparé d'avance. Pendant toute la journée on travailla avec la plus fiévreuse activité : nous connaissions maintenant le prix des minutes ; tout le monde sans exception met la main à l’œuvre ; les voyages se succèdent si rapidement qu'au coucher du Soleil presque tous nos colis et nos lourdes caisses d'instruments sont débarqués et empilés pêle-mêle sur les rochers avoisinant le débarcadère.
Nous couchons pour la première fois dans des huttes improvisées, à peine couvertes, mais avec la bien vive satisfaction d'avoir accompli pendant cette journée la partie la plus difficile et la plus dangereuse de la mission, si compromise encore la veille, et dont le succès ne dépendait plus maintenant que de l'état du ciel au 9 décembre.
Le lendemain matin un nouveau coup de vent interrompait les travaux et obligeait la Dives à s'éloigner de l'île ; son absence fut de courte durée cette fois ; deux jours après, le 4, elle revenait à son mouillage et débarquait le reste de nos caisses. Le temps conservait toujours fort mauvaise apparence.
M. le Ministre de la Marine m’avait donné l'ordre, par bienveillance pour la Mission, de garder ce navire à Saint-Paul, où sa présence m'aurait été, en effet, d'un grand secours ; mais il était trop gravement compromis par la persistance de ces affreux temps, et il n'avait plus d'ancre à perdre ; je me décidai donc, à mon très-grand regret, à le renvoyer à la Réunion avec l'ordre de venir nous chercher en décembre.
A 3 heures du soir, la Dives levait son ancre unique et disparaissait derrière la pointe de l'île, nous laissant livrés à nos propres ressources ; elle partait avec le commencement d'une tempête qui eut à peu près la même violence et la même durée que celle qui nous avait assaillis à notre arrivée et rendit fort difficiles nos premiers travaux d'installation, entièrement consacrés à satisfaire aux besoins les plus urgents de la vie matérielle, à construire les cabanes d'habitation, la cuisine, le four et la machine distillatoire pour faire de l'eau douce.
Les subites rafales tourbillonnantes qui tombaient du haut des falaises sur nos cabanes en construction, comme des coups de massue, défonçaient les toitures, en dispersaient les débris et nous obligeaient à chaque instant à recommencer le travail ; la grêle et la pluie étaient continuelles ; mais, au milieu de ces misères et de ces difficultés de toute nature, mes dignes et excellents collaborateurs ne cessèrent de montrer la plus grande énergie, l'abnégation la plus complète, et nos braves marins travaillaient toujours avec l'ardeur, l’intelligence et le dévouement inhérents à leur nature ; la plus parfaite entente régnait entre tous. L'expérience de ces nouvelles occupations leur vint d'ailleurs bien vite, et nous pûmes terminer en quelques jours une établissement assez confortable et assez solide, qui n'était guère perméable désormais qu'aux grandes pluies accompagnées de vent ; mais il devint bientôt aussi le refuge de tous les rats, souris et chats sauvages de l’île ; car ces animaux, au lieu de se faire la guerre, vivaient, malheureusement pour nous, dans la meilleure intelligence, ne se nourrissant tous que d’œufs et d'oiseaux de mer, parcourant familièrement nos chambres et ne négligeant d'ailleurs aucune occasion d'attaquer nos provisions et nos effets.
Les naturalistes se construisirent eux-mêmes un logement et un laboratoire très complets avec les armoires, les caisses et les meubles nécessaires rencontrés parmi les débris du naufrage ; ils purent dès le 15 octobre commencer leurs études et leurs collections.
La construction de l'observatoire sur le milieu de la chaussée de galets qui s'étendait au pied de notre campement exigea près d'un mois de travail ; vers le 1er novembre nos cinq principaux instruments étaient montés dans cinq cabanes différentes ; les observations, l'étude des instruments et les expériences préparatoires commencèrent aussitôt.
Pendant le mois de novembre, les coups de vent furent moins fréquents, l'approche de la belle saison se faisait sentir ; mais, au point de vue des observations astronomiques, il n'y avait nulle amélioration : les vents tièdes de l'équateur, qui remplaçaient les vents polaires, produisaient des brouillards intenses et persistants, bien plus dangereux encore pour les observations que le ciel si variable des tempêtes, pendant lesquelles survenaient souvent des éclaircies de plusieurs heures.
En temps ordinaire, du fond de notre cratère, nous apercevions bien rarement un ciel bleu ; comme toutes les îles élevées et isolées en pleine mer, les sommets de Saint-Paul arrêtent les nuages au passage et facilitent leur formation ; mais cette île présente en outre une particularité bien plus déplorable encore pour des astronomes. Les nombreuses sources d'eau chaude situées autour du bassin entretiennent une évaporation constante, les vapeurs s'élèvent le long des parois comme du fond d'une chaudière et vont se condenser en brouillards, au contact des vents froids de l'extérieur ; en octobre les tempêtes les dissipaient fréquemment, tandis qu'avec les calmes de l'été ils forment comme un couvercle qui, fermant le cratère d'une manière permanente, cache le zénith, même par les plus beaux temps et quand le soleil brille à quelques centaines de mètres tout autour de l'île.
Ces conditions étaient désastreuses pour notre observation du 9 décembre. Un seul espoir nous soutenait, c'était la ferme croyance de nos pêcheurs malgaches dans l'heureuse influence de la Lune : ils prétendaient qu'il y avait toujours une courte embellie le jour de la nouvelle Lune, et j’avais constaté ce fait singulier aux deux lunaisons précédentes avec une grande satisfaction car le 9 décembre était précisément un jour de nouvelle Lune.
Le mois de novembre fut encore signalé par un événement heureux ; le 17, la goélette de pêche le Fernand arrivait de la Réunion, nous apportant les premières nouvelles reçues de France depuis notre départ. Ces lettres étaient attendues avec une bien vive impatience par tout le personnel de la mission, qui put dès lors, sans préoccupation étrangère, se livrer aux travaux préparatoires de la grande observation du 9 décembre.
Malheureusement, à mesure qu'approche le moment critique, le temps semble empirer ; dès le 6, il prend mauvaise apparence ; le baromètre, qui été à 770, commence à descendre, le ciel est sombre dans toute l'étendue de l'horizon.
Le 7, fort vent, pluie et brouillard.
Le 8, la veille du passage, la baisse du baromètre continue toujours (à 751) ; la pluie est torrentielle et incessante, la mer fort grosse ; une deuxième goélette de pêche, arrivée la veille sur rade, casse ses ancres et disparaît emportée par le mauvais temps ; une brume épaisse enveloppe toute l'île, nous cachant les parois opposées du cratère. Je ne puis trouver un seul moment favorable pendant cette triste journée pour faire, conformément à l'ordre du jour distribué d'avance, la dernière répétition générale de l'observation avec tout le personnel à son poste ; la pluie est trop forte et trop continuelle. Cependant, bien que tout me paraisse absolument et irrévocablement perdu, nous n'en continuons pas moins nos dispositions, et nous terminons à minuit la préparation de nos deux cent cinquante plaques daguerriennes, que nous ne pouvions polir et sensibiliser qu'au dernier moment.
Quand nous nous couchons à minuit, la pluie est toujours aussi forte, le ciel est aussi sombre, et nos cabanes résistent avec peine à la violence de la tempête ; baromètre 749. Nous ne conservons plus la moindre lueur d'espérance.
La règle météorologique des Malgaches me paraissait cette fois bien malheureusement compromise, lorsque, vers 3 heures du matin, le vent sauta subitement du nord-est au nord-ouest, produisant une grande amélioration de temps ; la pluie cesse, le voile sombre qui couvrait le ciel se déchire ; de grosses masses de brume et de nuages très-bas; chassés par une forte brise, passent continuellement sur notre zénith, laissant fréquemment voir le ciel. Le baromètre remonte un peu à 751; au lever du soleil nous courons aux instruments ; les derniers préparatifs sont bien vivement terminés, et, vers 6h 30m, une demi-heure environ avant le premier contact, chacun est à son poste, entièrement prêt à remplir sa tâche, bien définie et étudiée d'avance.
J'étais à l'équatorial de 8 pouces, M. Turquet. était à l'équatorial de 6 pouces ; j'avais confié à M. Velain, très-exercé au maniement des instruments d'optique, une petite lunette astronomique de 3 pouces, avec laquelle il était allé s'établir sur le sommet de l'île ; MM. Cazin, Rochefort et leurs aides étaient à la photographie.
Le premier contact, le moins important des quatre, fut à peu près complètement manqué ; quand, dans une courte éclaircie, entre deux nuages, j'aperçus une première très-petite échancrure sur le point du disque solaire bien exactement indiqué par le fil du micromètre, elle était déjà un peu trop grande pour me permettre d'estimer avec assez de précision l'heure du contact. Je ne crois pas l'avoir obtenue à plus de 40 ou 50 secondes près.
Mais, à mesure que Vénus entrait sur le Soleil, les nuages devenaient de plus en plus rares, le ciel plus transparent, les images d'une très grande netteté. Un quart d'heure environ après le premier contact, quand la moitié de la planète était encore hors du Soleil, j'aperçus subitement tout le disque entier de Vénus, dessiné par une pâle auréole, plus brillante dans le voisinage du Soleil qu'au sommet de la planète.
Pour bien constater que je n'étais pas le jouet d'une illusion, je pris immédiatement des mesures micrométriques du diamètre de Vénus, dans le sens perpendiculaire ; bien que le premier de ces diamètres fût encore à moitié hors du Soleil et limité extérieurement seulement par l’auréole, j’obtins, à 1 seconde près, exactement la même valeur : c’était donc bien le disque entier très-net de la planète que j'apercevais.
Cette apparition, aussi remarquable qu'inattendue, peut sans doute être attribuée en partie à l'atmosphère solaire rendue visible par contraste, en partie aussi par l'atmosphère de Vénus. Le ciel était devenu si pur à la suite de la tempête et l'auréole était si brillante, qu’on peut voir sur nos photographies des traces de ce curieux phénomène.
Le deuxième contact fut observé dans de bonnes conditions vers 7h 30m ; mais, au lieu de voir l'apparence de la goutte noire, qui a pour effet de tenir les deux cornes encore séparées après le contact, j’ai vu le phénomène tout contraire : l’arc lumineux de l'auréole réunissait ces deux cornes avant le contact ; nous nous trouvions évidemment dans des conditions exceptionnellement favorables sous le rapport de la pureté de l'atmosphère et de l'excellence de notre lunette.
Depuis 7h 30m jusqu'à 11 heures, nous suivons la marche de Vénus sur le Soleil; très-rarement obscurci par des nuages.
Pendant toute la durée du passage, je prends un grand nombre de mesures de la distance de la planète au bord du Soleil ; malheureusement les fortes rafales qui agitent continuellement la lunette équatoriale, un peu trop faiblement montée pour sa grande dimension, m'empêchent de prendre ces mesures avec une précision suffisante : les oscillations s'élèvent au moins à 4" ou 5", quelquefois même jusqu'à 10", et je ne disposais que d'un micromètre à fil. Je ne puis donc guère répondre de mes mesures qu’à 1 seconde près ou 1",5.
La photographie fonctionne régulièrement et d'une manière continue ; nous recueillons plus de cinq cents bonnes épreuves pendant les quatre heures ; mais, à l'approche du troisième contact, les nuages commencèrent à revenir, courant avec une extrême rapidité à la hauteur des sommets de l'île.
J'étais tellement surpris de la durée tout à fait inusitée de cet état d'un ciel sans nuages, que je m’attendais à chaque instant à voir recommencer la pluie et la brume ; j'aurais voulu hâter la marche de la planète qui me semblait bien lente, et j'attendais avec une vive impatience ce troisième contact qui allait décider du sort de notre observation. A 11h 3m environ nous avons la bonne fortune de l'observer dans des conditions aussi favorables que le deuxième ; le succès de notre mission est maintenant assuré, mais il était temps d'en finir, car les nuages deviennent dès lors de plus en plus épais et serrés, et le quatrième contact, moins utile que les deux précédents, n'est obtenu qu'avec beaucoup de difficultés à travers la brume. A midi, je puis encore prendre le passage du Soleil au méridien pour fixer l'heure de nos observations, mais il est à peine visible, et, quelques minutes après, une pluie torrentielle, accompagnée de brouillard, recommençait comme la nuit précédente, le baromètre restant toujours très-bas et le ciel devenant très-sombre ; la tempête n'était pas terminée, mais seulement suspendue pendant les cinq heures de la durée du passage ; elle se prolongea encore pendant trente-six heures. Ce ne fut que le 11 que, le baromètre étant remonté à 765, le temps s'embellit définitivement et nous permit de faire quelques observations méridiennes pour régler nos pendules et nos chronomètres.
Nos pêcheurs malgaches s'étaient montrés bons météorologistes en nous soutenant par l'espoir d'une embellie le jour de la nouvelle Lune ; mais nous avions eu un bonheur bien extraordinaire : pendant les cinq heures de la durée du passage de Vénus, notre île s'était trouvée au centre même de la tempête, et nous avions profité de ces quelques heures d'embellie qu'on rencontre toujours au milieu d'un cyclone au moment où le baromètre atteint son niveau le plus bas. La pluie avait cessé une heure avant et avait recommencé quelques minutes après le phénomène.
La Dives, revenue la veille de l'île de la Réunion, était mouillée à 400 mètres de notre observatoire ; le capitaine Duperré, son état-major et son équipage, seuls témoins de nos péripéties, avaient suivi avec anxiété les diverses phases de notre observation, et, dès qu'elle fut terminée, la Dives hissait en tête de ses mâts le pavillon national et saluait de cinq coups de canon le succès inespéré de la mission française de l’île Saint-Paul.
J’avais vivement désiré dès lors effectuer notre retour en France, où je savais que le résultat de notre expédition était attendu avec anxiété ; mais, l'observation ayant réussi, une détermination exacte de la longitude était nécessaire, et nous n'avions pas encore obtenu de résultats satisfaisants à ce sujet. Bien que la saison des brumes épaisses eût commencé, je me décidai à rester un mois de plus, dans l'espoir de recueillir encore quelques observations de la Lune ; malheureusement, je ne pus en faire que deux assez incomplètes, jusqu'à la fin de décembre. Le mois de janvier n'en promettant pas davantage, je songeai au départ.
En trois mois, malgré notre extrême vigilance, nous n'avons donc pu obtenir que sept ou huit observations de culminations lunaires et encore pas une seule n'est complète. La latitude a été très exactement déterminée à l'aide de l'observation de 82 étoiles, passant à moins de 30 degrés du zénith, et de 18 ou 20 paires d'étoiles qui ont permis l'emploi de la méthode Talcott.
Nous pourrons avoir une autre détermination de la longitude en rapportant la position de Saint-Paul à la Réunion à l'aide de trois traversées faites avec trois ou quatre chronomètres; mais on ne pourra obtenir de résultat utile que quand la longitude de la Réunion ou de Maurice aura été déterminée par le télégraphe électrique qui va les réunir à l'Europe.
Pendant le mois de décembre, j'avais envoyé nos naturalistes explorer l'île d'Amsterdam, où des brumes épaisses les tinrent enfermés plusieurs jours de suite dans la grotte qu'ils avaient choisie pour domicile. Le résultat de leur excursion et les documents qu'ils en rapportent présentent néanmoins un très-haut intérêt ; l'intérieur de cette île d'un si difficile accès n'ayant encore été visité par aucune mission scientifique, c'est donc un véritable voyage de découverte qu'ils ont accompli.
Un dernier fait intéressant signale le mois de décembre ; à la suite d'un fort ras de marée, nous trouvons, échoué sur nos rochers, un calmar géant dont le corps avait 1m60 et les bras 6 mètres de longueur ; un énorme bec de perroquet, de gros yeux ronds très-saillants et de nombreux bras couverts de ventouses donnaient à cet animal si formidablement armé un aspect étrange et hideux, bien fait pour justifier les fables dont il est l'objet. Nous aurions voulu le rapporter en France, mais il aurait fallu une barrique entière d'eau-de-vie pour le conserver. L'état de notre approvisionnement ne nous permettant pas une semblable prodigalité, nous dûmes nous borner à en faire une photographie et à en disséquer les parties les plus intéressantes.
Le 4 janvier nous embarquons sur la Dives et nous quittons définitivement Saint-Paul, après avoir construit en blocs de rochers une belle pyramide commémorative, de 24 mètres de tour sur 9 mètres de hauteur, portant une pierre gravée qui rappellera le souvenir de l’observation de la mission française.
Chose étrange ! au moment de quitter cette île déserte pour rentrer dans le courant de la civilisation, de nous séparer de cette nature âpre et sauvage, d’échapper aux brumes et aux tempêtes pour nous rapprocher des contrées plus favorisées et des climats plus doux, aucun de nous ne pouvait s'empêcher de jeter un regard mélancolique sur ces sévères rochers ; nous éprouvions, tous, ces sentiments de tristesse et de regret qu'on ressent lorsqu'on serre pour la dernière fois la main d'un ami qu’on ne reverra plus. Les émotions si vives et si opposées qui nous avaient agités sur ce volcan à peine éteint et la parfaite harmonie qui avait toujours régné au milieu de nous nous rattachaient à lui : cette existence de Robinson, qui ramène l'homme vers la vie de la nature, n’est-elle pas d’ailleurs pleine d'un mystérieux attrait ?
Mais ces impressions s'évanouirent vite en même temps que la silhouette de l'île, qui disparut bientôt dans son éternelle enveloppe de brouillards et de tempêtes ; nos regards devançant la marche du navire, trop lente à notre gré, voyaient déjà poindre au loin l'image lumineuse de la patrie. La traversée de retour fut rapide ; au commencement de mars, l'expédition rentrait en France, heureuse d'avoir pu remplir, à la satisfaction de l'Académie, une mission acceptée avec le profond sentiment du devoir, mais entreprise avec si peu d'espoir de succès, qu'au moment où le phénomène achevait de s'accomplir nous nous demandions si nous n'avions pas été dupes d'un rêve trompeur, au lieu d'être les favoris d'une merveilleuse réalité.
RÉSULTAT DE L'OBSERVATION
DU PASSAGE DE VÉNUS A L’ILE SAINT-PAUL.
Latitude de l’Observatoire …. 38°42' 50",79 Sud (par 82 étoiles.)
Longitude, à 1 minute près….75°11' 00" Est (chron. et culminations lunaires.)
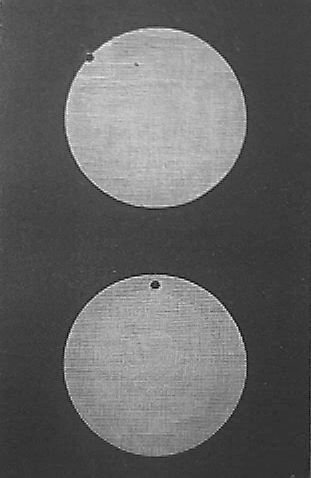
Ie fig. – Position de Vénus sur le bord du Soleil au moment de l’apparition de l’auréole de la planète.
IIe fig. – Position de Vénus sur le Soleil vers le milieu du passage (vraie grandeur des photographies).
| [1] | (∗) Lu dans la séance publique annuelle des cinq Académies, le 25 octobre 1875. |
| [2] | () Le personnel des quatre missions principales et des deux missions secondaires était composé de la manière suivante : Mission de l’île Campbell. M. Bouquet de la Grye, chef de mission, ingénieur hydrographe de la Marine. M. Gourrejolles, lieutenant de vaisseau. M. Filhol, naturaliste voyageur du Muséum. Mission de l’île Saint-Paul. M. Mouchez, chef de mission, capitaine de vaisseau. M. Cazin, professeur au lycée Condorcet. M. Turquet de Beauregard, capitaine de frégate. M. Velain, naturaliste, répétiteur à l'École des Hautes-Études, à la Sorbonne. M. Rochefort, médecin de 1re classe de la Marine. M. De l’Isle, naturaliste voyageur du Muséum. Mission de Nouméa. M. André, chef de mission, astronome de l’Observatoire de Paris, M. Angot, physicien attaché au Collège de France. Mission de Pékin. M. Fleuriais, chef de mission, lieutenant de vaisseau. M. Blarez, lieutenant de vaisseau. M. Lapied, enseigne de vaisseau. Mission de Yokohama. M. Janssen, chef de mission, membre de l'Institut. M. Tisserand, directeur de l'Observatoire de Toulouse. M. Picard, lieutenant de vaisseau. M. Delacroix, enseigne de vaisseau. M. Arents, artiste chargé de la photographie. M. Vacher, artiste mécanicien. M. Chimizou, attaché japonais, ancien élève de l’École centrale. Mission de Saïgon. M. Héraud, ingénieur hydrographe de la Marine. |